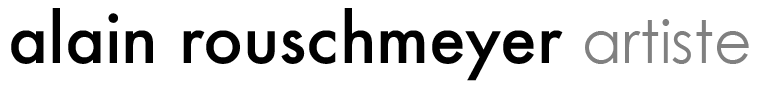Transparence à sens unique : quand l’artiste doit se mettre à nu face à des experts invisibles
On demande aujourd’hui à l’artiste de se livrer tout entier. D’expliquer sa démarche, de justifier son style, de raconter son passé, ses blessures, ses succès. De publier ses prix, son nombre de ventes, ses échecs parfois, et même sa sensibilité. Cette injonction à la transparence est devenue la norme — presque la condition d’entrée dans le marché de l’art contemporain.
Pour être vu, il faudrait tout dire. Pour être exposé, il faudrait s’exposer. Pour être écouté, il faudrait se dévoiler. L’artiste est prié de se raconter, souvent mieux qu’il ne crée.
Mais ce que je constate me met en colère : ceux qui imposent cette transparence ne se l’appliquent jamais à eux-mêmes. Qui sont ces curateurs qu’on nous présente comme "références" ? Quels parcours ont ces coachs artistiques qui, sans avoir jamais exposé eux-mêmes, enseignent la manière d’être visible ? Que sait-on de ces galeries qui se gardent bien d’indiquer qui choisit, selon quels critères, et pourquoi ?
Photo de Kristina Tripkovic sur Unsplash
L’artiste sommé de tout dire
C’est devenu un passage obligé : parler de soi, avec sincérité, profondeur, et si possible un peu de vulnérabilité. L’artiste est devenu à la fois auteur, vendeur, marketeur et confident.
Il faut publier, commenter, justifier. Il faut expliquer son style, sa palette, ses choix — et souvent même son histoire intime. C’est l’ère du storytelling permanent, où l’image de soi finit par recouvrir l’œuvre elle-même.
Dans ce monde ultra-connecté, être discret serait presque suspect. Et pourtant, la création naît parfois du silence, du retrait, de l’ombre.
Les experts, eux, restent derrière la vitre
À l’inverse, ceux qui orientent les regards restent souvent parfaitement opaques. Leur biographie est floue, leur pratique artistique inexistante ou illisible, leur légitimité rarement questionnée.
On devrait les croire sur parole. Accepter leurs choix, leurs jugements, leurs tarifs. Prendre pour argent comptant une autorité qui n’a souvent d’autre preuve qu’un site bien fait ou un ton affirmé.
Ils organisent des expositions sans nommer ceux qui sélectionnent. Ils évaluent les démarches artistiques sans jamais exposer la leur. Ils font des promesses sans livrer leur passé.
Et l’artiste, souvent isolé, trop heureux d’être "repéré", accepte ce déséquilibre. Parce que c’est le prix pour "avancer". Parce qu’il faut bien faire confiance. Parce que c’est comme ça.
Une colère qui vient de loin
Ce n’est pas une simple irritation. C’est une colère plus profonde, celle de constater un système déséquilibré, voire pervers.
Un système qui exige de l’artiste qu’il se mette à nu, mais qui protège soigneusement ceux qui organisent, jugent, vendent, ou forment.
Cette asymétrie blesse, surtout les plus jeunes ou les plus sincères. Elle décourage ceux qui n’ont pas le langage du pitch mais le souffle de l’atelier. Elle écrase ceux qui n’ont pas les codes mais tout à dire.
Et surtout, elle installe un climat où l’autorité n’est plus liée à l’expérience ou à la création, mais à la capacité de se rendre crédible sans jamais se rendre visible.
L’influence masquée des experts "pour tous"
Il y a une autre ironie, plus subtile encore. Ces curateurs, ces coachs, ces galeries invisibles revendiquent bien souvent un art "accessible", un art "pour tous", un art démocratisé.
Ils manient les mots de l’inclusion, de la pédagogie, du partage. Mais dans les faits, ils imposent leur propre légitimité sans jamais l’exposer à la critique.
Ils influencent les regards, orientent les choix, sélectionnent les œuvres — et les artistes — sans que le public n’ait accès à leurs critères, à leurs doutes, à leurs failles.
Ils construisent une autorité sans contre-pouvoir, tout en affirmant vouloir "ouvrir l’art".
C’est une façade, parfois bienveillante en apparence, mais fondée sur l’invisibilité.
J’ai déjà abordé cette tension dans un autre article : L’art pour tous ? Non merci. — et elle mérite d’être relue à la lumière de cette réflexion.
Pour une éthique de la réciprocité
Alors non, ce n’est pas un rejet de toute collaboration. Ce n’est pas un mépris des métiers de l’accompagnement, de la médiation, de la curation.
Mais si l’artiste doit se raconter, que les autres aussi montrent leur chemin. Qu’ils révèlent leurs pratiques, leurs influences, leurs échecs et leurs doutes. Qu’ils disent pourquoi ils choisissent, et ce qui les rend légitimes à le faire.
Sinon, ce n’est pas de l’aide. C’est une domination douce.
Et si l’on veut vraiment parler d’éthique artistique, de partage, d’art vivant, alors commençons par équilibrer les rôles.
Parce que la transparence ne peut pas être une obligation pour l’un, et une option pour l’autre.